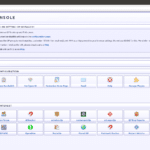Depuis plusieurs semaines, Google commence à déployer ses nouvelles fonctionnalités de recherche basées sur l’intelligence artificielle (AI Overviews, Multisearch, etc.) dans plusieurs pays européens comme l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique ou encore l’Italie. La France, elle, reste à la porte. Officiellement, ce retard s’explique par des incertitudes juridiques. Mais si la raison était ailleurs ? Et si cette non-disponibilité était une forme de pression douce, une stratégie de coercition visant à peser sur les choix politiques d’un pays ?
Des raisons officielles : les droits voisins au cœur du blocage
Selon Google, le déploiement de ses nouvelles fonctionnalités en France est freiné par la complexité du cadre juridique, notamment autour des « droits voisins ». Ces derniers, instaurés par une directive européenne transposée en France en 2019, visent à rémunérer les éditeurs de presse pour l’utilisation de leurs contenus par des plateformes comme Google News ou Search (source : Numerama).
En réaction, Google avait déjà adopté une position de retrait en 2019, suspendant temporairement l’affichage des extraits d’articles pour la presse française dans ses résultats de recherche. Finalement, sous pression politique et médiatique, des accords ont été trouvés, notamment avec l’Alliance de la presse d’information générale (APIG).
Mais la méfiance de Google semble persister. Le groupe pourrait craindre que l’intégration de ses nouveaux outils d’IA dans la recherche ne soit exploitée par les autorités françaises pour exiger de nouvelles rémunérations, voire de nouvelles contraintes réglementaires.
Une stratégie de pression douce ?
Le choix de ne pas déployer ces fonctionnalités en France pourrait être interprété comme un signal politique. En somme : « si vous nous mettez des bâtons dans les roues, nous ralentirons l’accès à l’innovation pour vos citoyens ». Un rapport de force implicite, mais bien réel.
Ce type de comportement n’est pas nouveau. En 2014, Google avait menacé de déréférencer les sites d’actualité espagnols de Google News, après l’adoption d’une loi similaire à celle des droits voisins. Et en 2021, en Australie, Google et Facebook avaient adopté une posture similaire face à la réglementation sur la rémunération des médias.
Un impact sociétal à ne pas sous-estimer
Privée de ces nouvelles fonctionnalités, la France se retrouve en retrait sur l’expérience utilisateur. AI Overviews, par exemple, permet une synthèse rapide et contextuelle des résultats, révolutionnant la manière de chercher et de comprendre l’information. Cette absence constitue un véritable handicap cognitif et informationnel pour les utilisateurs français, comparés à ceux des pays où ces outils sont déployés.
Au-delà du confort d’usage, cela pose la question de l’équité d’accès à l’information. Peut-on tolérer que la qualité de l’information soit modulée en fonction des rapports de force entre une entreprise privée et un État ?
Le risque d’une coercition à grande échelle
Si Google commence à conditionner l’accès à ses innovations selon les territoires, rien n’empêche d’imaginer des extensions de cette logique :
- Une cartographie différente sur Google Maps selon les politiques d’un pays.
- Des ralentissements ou limitations sur Gmail ou YouTube.
- Des priorités de référencement modulées en fonction des alliances éditoriales ou politiques.
Cela interroge directement notre souveraineté numérique. Pouvons-nous accepter qu’un acteur privé étranger décide unilatéralement de la manière dont nos citoyens accèdent à l’information ou aux outils du quotidien ?
En conclusion : un enjeu bien plus large qu’une simple fonctionnalité absente
Le non-déploiement des nouvelles recherches Google en France ne doit pas être considéré comme un simple « retard technique ». Il s’agit d’un symptôme de tensions profondes entre les GAFAM et les souverainetés nationales. L’impact est direct sur les citoyens, qui se retrouvent avec une version appauvrie du web, et indirect sur le pouvoir régulateur des États.
Il est urgent d’engager une réflexion sur notre dépendance à ces plateformes, et de soutenir des alternatives ouvertes, transparentes et véritablement européennes.
A l’heure où l’État français joue les trouble-fêtes diplomatiques avec une Europe divisée et prudente, on observe un élan nationaliste belliqueux relayé par certains médias qui laissent croire que la France pourrait peser seule dans les équilibres mondiaux. Pendant que certains se gargarisent de produire des armes, d’autres nient l’importance cruciale de la compétence numérique et de la compréhension des véritables leviers de pouvoir global. Un boycott symbolique de produits américains n’a que peu de poids face à l’étranglement progressif des services stratégiques que les GAFAM peuvent imposer. Cet étouffement silencieux, par la privation ciblée d’accès ou de fonctionnalités, pourrait bien être l’un des leviers les plus puissants de neutralisation d’une nation.
Sources :
- https://www.numerama.com/tech/1936279-les-nouvelles-recherches-google-arrivent-partout-sauf-en-france-pourquoi.html
- https://kulturegeek.fr/news-315584/google-pixel-9-plusieurs-fonctions-dia-indisponibles-france
- https://foxglove-partner.com/google-devoile-ses-nouvelles-fonctionnalites-de-recherche/
- Directive européenne 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique